Introduction : pourquoi soigner les patientes enceintes ?
De nombreuses femmes enceintes hésitent à consulter le dentiste par crainte pour leur futur bébé, et certains praticiens redoutent également d’intervenir pendant la grossesse. Pourtant, il n’existe aucune contre-indication aux soins dentaires chez la femme enceinte, au contraire : négliger la santé bucco-dentaire pendant la grossesse peut favoriser des complications obstétricales. Par exemple, les maladies parodontales maternelles sont associées à un risque accru de prématurité, de prééclampsie, de retard de croissance intra-utérin et de faible poids de naissance. Ainsi, les problèmes dentaires de la femme enceinte doivent être traités sans délai afin d’éviter ces risques.
Ce guide récapitule les précautions à prendre et les recommandations actualisées pour la prise en charge des patientes enceintes au cabinet dentaire, en s’appuyant sur des sources médicales fiables (OMS, HAS, ADA, ACOG, etc.).
Adaptation des soins selon le trimestre de grossesse
La conduite à tenir peut varier en fonction de l’avancement de la grossesse, principalement pour des questions de confort maternel et de risques spécifiques à chaque trimestre :
-
Premier trimestre (0–3 mois) : Période sensible (organogenèse en cours, risque accru de fausse couche). Limitez-vous aux soins urgents indispensables (extractions d’urgence, traitements endodontiques pour enrayer une infection ou une douleur aiguë). Il est préférable de reporter les soins non urgents après le 3^e mois. De plus, les nausées/vomissements et l’hypersalivation du premier trimestre peuvent compliquer les séances de soins.
-
Deuxième trimestre (4–6 mois) : C’est la période idéale pour intervenir : le fœtus est formé et la patiente est généralement dans un état confortable. On pourra réaliser les soins conservateurs nécessaires (soins de caries, dévitalisations, extractions non urgentes) afin de maîtriser les foyers infectieux ou douloureux évolutifs. En revanche, les traitements lourds multiples ou à long terme (gros travaux prothétiques, chirurgies complexes programmées) seront de préférence différés après l’accouchement.
-
Troisième trimestre (7–9 mois) : À l’approche du terme, la patiente peut être gênée par la taille du ventre, moins à l’aise en position allongée, et un accouchement prématuré devient un risque à considérer. On privilégiera là encore les soins urgents et palliatives pour soulager la patiente (par exemple traiter une douleur aiguë, drainer un abcès). Les séances seront courtes, avec des pauses si nécessaire, et la patiente installée en décubitus semi-assis ou avec un léger décubitus latéral gauche plutôt qu’à plat dos, afin d’éviter le syndrome hypotensif par compression de la veine cave.
En résumé, en l’absence d’urgence il est conseillé de programmer les soins dentaires au 2^e trimestre lorsque possible, mais toute urgence dentaire doit être gérée sans attendre quel que soit le terme. L’abstention de soins en cas de douleur ou d’infection représente un plus grand danger pour la grossesse que l’intervention elle-même.
Médicaments autorisés et contre-indiqués pendant la grossesse
Lors de la prescription médicamenteuse pour une patiente enceinte, le chirurgien-dentiste doit choisir des molécules efficaces tout en évitant celles présentant des risques pour le fœtus. Bonne nouvelle : de nombreux médicaments usuels en dentisterie sont utilisables pendant la grossesse, notamment la plupart des antibiotiques courants et le paracétamol. En revanche, certains antalgiques et anti-inflammatoires sont contre-indiqués à certaines périodes. Le tableau ci-dessous récapitule les principales recommandations :
Remarques et justifications : Le paracétamol est l’analgésique de référence pendant la grossesse, car il est efficace et dépourvu d’effet tératogène aux posologies usuelles. À l’inverse, l’aspirine et les AINS (ibuprofène, kétoprofène, etc.) sont formellement contre-indiqués à partir du 3^e trimestre en raison de leur foetotoxicité (fermeture prématurée du ductus artériosus entraînant une détresse cardiaque néonatale, risque hémorragique maternel et fœtal). Ils sont également déconseillés au 1^er trimestre (soupçonnés d’augmenter le risque de fausse couche et certaines malformations), et ne devraient être utilisés au 2^e trimestre qu’en dernier recours sur une très courte durée. Si une douleur aiguë ne cède pas au paracétamol seul, le praticien peut envisager un antalgique opioïde faible en deuxième intention, par exemple de la codéine, en veillant à la prescrire à la dose minimale et pendant la durée la plus brève possible. Les dérivés codéinés sont à éviter en début de grossesse (un faible lien avec des malformations cardiaques ou palatines a été évoqué) et proscrits en fin de grossesse pour ne pas entraîner de dépression respiratoire du nouveau-né. En cas de douleur très intense (cellulite dentaire par exemple) non contrôlée par ces moyens, un opioïde plus puissant comme la morphine peut exceptionnellement être utilisé quel que soit le terme sous strict contrôle médical, de préférence en milieu hospitalier ; il faudra alors prévenir l’équipe néonatale si l’accouchement est proche, afin d’anticiper une éventuelle dépression néonatale.
Concernant les antibiotiques, la plupart de ceux utilisés en odontologie sont sans danger pendant la grossesse. Les pénicillines (amoxicilline, amoxicilline + acide clavulanique) sont le choix de première ligne pour traiter les infections dentaires chez la femme enceinte. Les céphalosporines de première génération, l’érythromycine, l’azithromycine ou la spiramycine sont également sûres (aucune toxicité ni tératogénicité avérée). La clindamycine (lincosamide) est autorisée et utile en cas d’allergie à la pénicilline. Le métronidazole (anti-bactérien nitro-imidazolé) peut être prescrit si nécessaire, notamment à partir du 2^e trimestre, les données n’ayant pas montré d’effet malformatif significatif – il convient toutefois d’éviter son usage par confort durant les premières semaines si une alternative existe. À proscrire absolument : les tétracyclines (doxycycline, minocycline…), surtout à partir du 4^e mois, car elles induisent des anomalies dentaires (dépôts dans l’émail et la dentine du bébé provoquant des dents grises jaunâtres plus tard) et des troubles du développement osseux, sans parler du risque de toxicité hépatique maternelle. De même, les fluoroquinolones (ciprofloxacine, ofloxacine…) sont déconseillées pendant la gestation en raison d’effets indésirables potentiels sur le cartilage articulaire fœtal, et du fait qu’il existe presque toujours une alternative plus sûre pour les infections bucco-dentaires (elles ne devraient n’être envisagées que sur conseil d’un spécialiste, dans des situations très particulières).
Enfin, les antiseptiques locaux couramment employés en pratique dentaire (bains de bouche à la chlorhexidine, chlorure de cétylpyridinium, pastilles ou gels antiseptiques) peuvent être utilisés sans crainte pendant la grossesse. Ces produits ont une absorption systémique minime et aucun effet néfaste n’a été rapporté chez la femme enceinte ou le fœtus. On veillera simplement à choisir de préférence des bains de bouche sans alcool (pour éviter le risque d’inconfort sur des gencives éventuellement inflammatoires, et limiter l’exposition à l’alcool). À noter que la povidone iodée (Bétadine® et dérivés), antiseptique utilisé sur les plaies et muqueuses, n’est pas contre-indiquée ponctuellement (par exemple pour désinfecter le champ opératoire avant une chirurgie buccale), mais son usage prolongé et répété est déconseillé car l’iode en excès peut théoriquement perturber la fonction thyroïdienne fœtale.
Résumé pratique – prescription chez la femme enceinte : En première intention, privilégier les médicaments ayant fait leurs preuves de sécurité (paracétamol pour la douleur, amoxicilline ou érythromycine pour une infection…). Éviter systématiquement les classes connues pour leurs effets indésirables sur la grossesse (tétracyclines, AINS au 3^e trimestre…). En cas de doute sur un médicament, ne pas hésiter à consulter un référentiel actualisé ou à contacter un centre de pharmacovigilance.
Anesthésie locale : précautions et protocole chez la patiente enceinte
Produits anesthésiques utilisables et choix du vasoconstricteur
Tous les anesthésiques locaux usuels sont autorisés pendant la grossesse, à n’importe quel stade, et une anesthésie dentaire peut être réalisée sans danger quelle que soit l’avancée de la gestation. Les produits couramment employés en cabinet (lidocaïne, articaïne, mépivacaïne, prilocaïne, bupivacaïne…) traversent tous la barrière placentaire à des degrés divers, mais aux doses utilisées en odontologie ils ne présentent pas de toxicité pour l’embryon ou le fœtus. Il est d’ailleurs beaucoup plus risqué pour le bébé que sa mère subisse une douleur intense ou un stress prolongé faute d’anesthésie adéquate, que d’administrer l’anesthésique local en bonne quantité.
Dans la pratique, il est recommandé de privilégier la lidocaïne (Xylocaïne® 2 % adrénalinée par ex.) pendant la grossesse, car c’est la molécule la mieux documentée chez la femme enceinte (elle est utilisée depuis des décennies sans problème). Les données scientifiques sur l’articaïne et la mépivacaïne en tout début de grossesse sont en effet plus limitées, bien que rien n’indique une toxicité particulière de ces molécules. Si le cabinet ne dispose que d’articaïne (Alphacaïne®, Septanest®, Ubistésine®…) – anesthésique très répandu en France – on peut tout à fait l’utiliser y compris chez une patiente enceinte : certaines sources considèrent même que l’articaïne est un excellent choix en raison de sa forte liaison aux protéines plasmatiques et de sa métabolisation rapide, limitant son passage placentaire. En réalité, lidocaïne et articaïne sont toutes deux de bons choix (elles sont classées catégorie B par la FDA), et aucune malformation ni effet foetal n’a été rapporté avec ces anesthésiques en pratique dentaire. La prilocaïne et la mépivacaïne peuvent également être utilisées, mais elles n’offrent pas d’avantage particulier par rapport aux précédentes.
L’utilisation d’un vasoconstricteur (adrénaline) associé à l’anesthésique est non seulement permise, mais même recommandée. En effet, l’adrénaline permet de réduire le passage systémique de l’anesthésique local en constrictant les vaisseaux sur place, ce qui augmente l’efficacité et la durée de l’anesthésie tout en diminuant les saignements au champ opératoire. Ceci contribue à raccourcir l’intervention et à mieux contrôler la douleur, ce qui est bénéfique pour la mère et le fœtus. Attention toutefois à l’injection intravasculaire accidentelle : il faut impérativement aspirer avant chaque injection pour éviter un passage brutal d’adrénaline dans la circulation maternelle qui provoquerait tachycardie, hypertension et anxiété. Utilisée en infiltration locale aux doses dentaires usuelles (0,04 à 0,1 mg d’adrénaline par carpule selon les formulations), l’adrénaline n’a pas d’impact significatif sur la vascularisation utéroplacentaire. On limitera simplement le nombre de carpules d’anesthésie adrénalinée à ce qui est strictement nécessaire pour un confort optimal de la patiente.
En résumé, un anesthésique local avec adrénaline est le standard à appliquer chez la patiente enceinte, comme pour n’importe quel patient, afin d’obtenir une analgésie suffisante. Un manque d’anesthésie conduirait à une douleur et un stress néfastes pour le bon déroulement de la grossesse.
Physiologie particulière de la grossesse et implications en anesthésie
Quelques éléments physiologiques chez la femme enceinte méritent d’être connus du praticien, car ils peuvent influencer l’efficacité de l’anesthésie ou les précautions à prendre :
-
Hypervascularisation et pH tissulaire modifié : Sous l’effet des hormones de grossesse, on observe une hyperhémie des muqueuses et une légère acidification des tissus. Ceci peut réduire l’efficacité des anesthésiques locaux (qui sont des bases faibles) car la forme ionisée du produit prédomine dans un milieu acide et pénètre moins bien dans les fibres nerveuses. En pratique, il peut être un peu plus difficile d’anesthésier une femme enceinte : il n’est pas rare d’observer des insuffisances d’analgésie ou des besoins accrus en anesthésique pour obtenir le même effet. Le dentiste devra en être conscient et s’assurer d’administrer une dose suffisante et au bon emplacement (penser aux tronculaires plutôt qu’aux infiltrations si nécessaire, etc.), tout en respectant les doses maximales.
-
Diminution des protéines plasmatiques : La grossesse entraîne une baisse de la protidémie (hémodilution), ce qui augmente la fraction libre des anesthésiques locaux dans le sang. Cependant, les doses utilisées en odontologie restent très inférieures aux doses toxiques (ex : dose toxique lidocaïne ~ 400 mg, largement au-dessus des ~ 40 à 100 mg administrés généralement). Il convient simplement de ne pas surdoser et de toujours aspirer pour éviter l’injection intraveineuse, comme évoqué plus haut.
-
Position de la patiente pendant l’anesthésie : À partir du 3^e trimestre, il est important d’éviter que la patiente reste à plat dos trop longtemps, en raison du risque de syndrome de compression aorto-cave (le poids de l’utérus peut comprimer la veine cave inférieure et réduire le retour veineux). Ceci peut provoquer malaise, hypotension maternelle et souffrance fœtale aiguë. Privilégiez une position semi-assise sur le fauteuil, ou placez un coussin sous la hanche droite de la patiente pour la basculer légèrement sur le côté gauche pendant les soins. Ainsi, l’anesthésie pourra agir dans de bonnes conditions de sécurité.
Anesthésie générale et sédation consciente : Les traitements dentaires sous anesthésie générale sont rarissimes en cabinet libéral, et doivent être décidés en concertation pluridisciplinaire. Si une anesthésie générale est envisagée (par exemple pour une chirurgie bucco-dentaire importante chez une patiente phobique), il faudra impérativement impliquer l’obstétricien – l’AG n’est pas contre-indiquée en soi, mais on lui préfère la locorégionale dès que possible. De même, la sédation consciente au fauteuil (hors protoxyde d’azote) utilisant des benzodiazépines IV ou autres sédatifs n’est généralement pas recommandée chez la femme enceinte en dehors d’un milieu hospitalier, sauf si le bénéfice l’emporte largement (certains de ces médicaments peuvent avoir des effets sur le fœtus, surtout au 1^er trimestre). Nous aborderons plus loin la question de la gestion de l’anxiété, notamment via le protoxyde d’azote.
Radiographies dentaires et grossesse
La radiographie est souvent source d’inquiétude pour les patientes enceintes en raison des rayonnements ionisants. Pourtant, les examens radiographiques dentaires bien menés exposent l’embryon/fœtus à des doses extrêmement faibles, sans danger avéré. Selon l’American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG), les radiographies dentaires peuvent être effectuées en toute sécurité pendant la grossesse, à n’importe quel stade, dès lors qu’une protection adaptée est utilisée.
Voici les points clés concernant l’imagerie dentaire chez la femme enceinte :
-
Dose de radiation en jeu : Une radiographie intrabuccale (rétro-alvéolaire ou bite-wing) délivre une dose de l’ordre de 1 à 8 microGray (µGy) au niveau de l’utérus, c’est-à-dire bien en dessous du seuil de 100 mGy considéré comme potentiellement à risque pour le fœtus. En pratique, les doses sont infimes comparées à d’autres examens médicaux. Par exemple, un panorama dentaire ou un scanner CBCT délivrent une dose plus élevée qu’un cliché intra-oral, mais restent de l’ordre de quelques centaines de µGy au maximum dirigés principalement vers la région de la tête, ce qui est négligeable pour l’enfant à naître.
-
Pas de refus systématique si l’examen est nécessaire : Compte tenu de ces faibles doses et de la localisation de la tête éloignée de l’utérus, il n’y a pas lieu de refuser une radiographie dentaire indispensable sous prétexte de grossesse. Ne pas réaliser une radiographie peut conduire à manquer un diagnostic (carie profonde, infection), et donc à retarder un traitement utile. L’ACOG comme l’ADA (Association Dentaire Américaine) encouragent les soignants à poursuivre les actes de diagnostic pendant la grossesse, y compris les radios, si cela est justifié cliniquement.
-
Protections recommandées : Par mesure de précaution et pour rassurer la patiente, il est recommandé d’utiliser un tablier de plomb (tablier plombé) sur l’abdomen et, si possible, un cache-thyroïde pendant les radiographies. Ces protections réduisent encore davantage l’exposition du fœtus même si, on l’a vu, les doses dentaires sont déjà très faibles. Veillez à collimer le faisceau RX sur la zone d’intérêt et à utiliser des techniques à champ limité (cônes longs, capteurs numériques ou films à haute sensibilité).
-
Moment à privilégier : Il est sage, par principe de précaution, d’éviter les radiographies non urgentes durant le 1<sup>er</sup> trimestre. Si une radio de contrôle peut être repoussée au 4^e mois sans conséquence, il est raisonnable d’attendre. En revanche, en cas de nécessité diagnostique pour une urgence dentaire, on peut réaliser une radiographie à n’importe quel trimestre, y compris au 1^er, en prenant les précautions citées. Le 2^e trimestre est le moment le plus serein pour faire des examens si besoin. Au 3^e trimestre, on peut également réaliser les clichés requis, en veillant au confort de la patiente (position semi-assise pour l’installation comme mentionné précédemment).
-
Types de clichés : Les radiographies intrabuccales et panoramiques sont les plus fréquentes et ne posent pas de problème particulier si justifiées. Le cone beam (CBCT) et le scanner médical quant à eux ne devraient être envisagés qu’en cas de nécessité absolue pendant la grossesse, compte tenu de la dose plus élevée. Si un examen volumique 3D est crucial (par ex. suspicion de foyer infectieux profond, traumatisme facial…), il sera réalisé de préférence au 2^e trimestre et avec toutes les mesures de protection.
En somme, les radiographies dentaires, lorsqu’indiquées, sont sans danger pendant la grossesse avec un minimum de précautions. Il convient de bien l’expliquer aux patientes pour lever leurs peurs. On rappellera qu’au quotidien, une femme enceinte est exposée à bien plus de radiations naturelles de fond (cosmiques et terrestres) qu’elle ne le sera en passant une radiographie dentaire isolée. Il vaut mieux traiter une infection dentaire à temps avec l’aide d’une radio, plutôt que de la laisser s’aggraver par refus de faire un cliché.
(À noter : l’imagerie par résonance magnétique (IRM) n’implique pas de rayons X et peut être réalisée en cas de besoin pendant la grossesse. Quant aux examens radiologiques hors domaine dentaire, ils suivent des recommandations spécifiques mais sortent du cadre de cet article.)
Traitement des urgences dentaires pendant la grossesse
Les urgences odontologiques (douleurs aigües, infections, traumatismes) doivent être prises en charge sans délai chez la femme enceinte, car la douleur sévère et l’infection sont délétères pour la mère comme pour le fœtus. Il n’y a aucune raison de laisser souffrir une patiente enceinte ou de reporter un traitement urgent à cause de la grossesse : un abcès dentaire évolutif, par exemple, expose à un risque de dissémination infectieuse pouvant provoquer de la fièvre, des contractions utérines, voire un accouchement prématuré si l’infection devient sévère. De plus, la douleur intenses entraîne la libération de catécholamines de stress qui peuvent réduire la vascularisation utéro-placentaire. En clair, ne pas traiter une urgence dentaire est bien plus risqué que de la traiter correctement.
Principes généraux de prise en charge d’une urgence dentaire chez la femme enceinte :
-
Évaluation et diagnostic complet : comme pour tout patient, il faut déterminer l’origine de l’urgence (pulpite irréversible ? abcès péri-apical ? cellulite ? fracture dentaire ? gingivite ulcéronécrotique ? etc.) afin d’adopter le bon traitement. Ayez le réflexe de demander depuis quand elle est enceinte et si la grossesse se déroule normalement, mais ne perdez pas de temps sur les formalités en cas de douleur aigue : soulagez rapidement.
-
Anesthésie efficace : réalisez une anesthésie locale adaptée pour traiter sans douleur (cf. section anesthésie plus haut). Veillez à la position semi-assise si elle est en fin de grossesse. Une anesthésie locorégionale bien conduite ne présente pas de danger et est la clé d’un soin urgent réussi.
-
Traitement causal immédiat : On intervient sans différer. Par exemple, face à une pulpite aiguë (rage de dent) sur une carie profonde, n’hésitez pas à engager le traitement endodontique : ouvrez la chambre pulpaire, réalisez une pulpotomie ou extirpation pulpaire sous digue pour éliminer la source de la douleur, puis médication intracanalaire et pansement provisoire. La patiente sera soulagée et vous terminerez le traitement à la séance suivante. De même, en cas d’abcès dentaire (phlegmon apical) : il faut drainer le pus. Soit par un accès endodontique (pulpe nécrosée) soit par incision si collection fluctuante, après anesthésie. Drainez systématiquement les abcès collectés, même chez la femme enceinte – c’est le geste principal qui améliore le pronostic. Pour une infection parodontale (abcès gingivo-parodontal), éliminez le corps étranger s’il y a lieu, faites un nettoyage sous-gingival doux et rincez au sérum antiseptique. En cas de périoricoronarite aiguë (inflammation autour d’une dent de sagesse), rincez, désinfectez, et envisagez l’extraction de la dent causale si nécessaire une fois l’épisode aigu maîtrisé (de préférence au 2^e trimestre).
-
Prescription associée si besoin : en présence d’une infection bactérienne avérée, n’hésitez pas à prescrire un antibiotique adapté après avoir mis en œuvre le drainage mécanique. L’amoxicilline est l’antibiotique de premier choix en odonto-stomatologie (500 à 1000 mg x3/j), éventuellement combinée au métronidazole si l’infection est à germes anaérobies (parodontite apicale suppurée par ex, après 14 SA par précaution) – ou la spiramycine en cas d’allergie. La douleur sera gérée par paracétamol (1g toutes les 6h maximum). Évitez les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) en phase aiguë chez la femme enceinte ; préférez ajouter de la codéine au paracétamol en cas de douleur intense mal soulagée initialement. N’oubliez pas les mesures locales : bain de bouche à la chlorhexidine 0,12% en relais d’un curetage gingival, par exemple, pour assainir en attendant la guérison.
-
Surveillance rapprochée : assurez-vous de recontrôler la patiente jusqu’à résolution de l’urgence. Une fois l’épisode aigu passé, planifiez le suivi du soin (finir la racine, restaurer la dent temporairement traitée en urgence, etc.) au moment opportun (souvent au 2^e trimestre).
Heureusement, la majorité des soins dentaires urgents se déroulent sans complications et soulagent immédiatement la patiente enceinte. Les actes courants comme les extractions, les dévitalisations ou la pose de plombages sont tout à fait possibles pendant la grossesse – ils peuvent être réalisés à n’importe quel trimestre si c’est justifié, d’après l’ACOG et l’ADA. Par exemple, une dent délabrée infectée pourra être extraite en toute sécurité, l’essentiel étant d’assurer une bonne anesthésie et un protocole d’asepsie rigoureux (comme pour tout patient). On évitera simplement si possible les chirurgies invasives multiples en fin de grossesse, pour des raisons de confort.
Matériaux dentaires et précautions diverses : Les matériaux d’obturation usuels (résines composites, verres ionomères, eugénate…) peuvent être employés chez la femme enceinte – aucune étude n’a montré de passage placentaire ou d’effet toxique de leurs composants. La seule réserve concerne les amalgames au mercure : par principe de précaution environnemental et sanitaire, l’utilisation de l’amalgame dentaire est désormais interdite chez les femmes enceintes dans l’Union Européenne (règlementation suite à la convention de Minamata, en vigueur depuis Juillet 2018). Il convient donc de choisir un autre matériau de restauration (CVIMAR, composite…) et d’éviter de déposer d’anciens amalgames pendant la grossesse sauf nécessité absolue. Si une dépose d’amalgame s’impose en urgence (carie récidivante sous un amalgame par ex.), on prendra un maximum de précautions : utilisation de la digue, aspiration chirurgicale performante, etc., pour minimiser l’inhalation de vapeurs de mercure.
Enfin, rappelons quelques conseils d’hygiène en urgence : face à des douleurs gingivales ou dentaires chez la femme enceinte, il est utile de rappeler les mesures d’appoint : bains de bouche au bicarbonate de sodium après les vomissements pour neutraliser l’acidité (nausées gravidiques fréquentes au 1^er trimestre), utilisation d’une brosse à dents souple si les gencives saignent (plutôt que d’arrêter de brosser), alimentation limitée en sucres rapides pour ne pas nourrir le foyer carieux, etc. L’éducation et la prévention font partie intégrante de la prise en charge, même en situation d’urgence.
Gestion de l’anxiété chez les patientes enceintes
De nombreuses femmes enceintes peuvent être anxieuses à l’idée de recevoir des soins dentaires, par peur d’avoir mal ou de nuire au bébé. À cela s’ajoute parfois une anxiété préexistante vis-à-vis du dentiste (phobie dentaire, mauvaise expérience passée) qui peut être exacerbée pendant la grossesse. La prise en charge de cette anxiété repose sur plusieurs approches complémentaires :
Approche psychologique et comportementale
Le stress de la patiente doit être minimisé par l’instauration d’une relation de confiance et d’un dialogue rassurant dès le début de la consultation. Prenez le temps d’écouter les préoccupations de la future maman et de lui expliquer chaque geste en insistant sur son innocuité pour le fœtus (par exemple : « Nous allons faire une anesthésie locale qui est sans risque pour votre bébé, afin que vous ne ressentiez aucune douleur »). Souvent, le fait de détailler le déroulement du soin et les mesures de sécurité (port du tablier plombé pour une radio, etc.) soulage grandement l’anxiété.
Conseils concrets pour réduire l’anxiété au fauteuil :
-
Instaurer un climat rassurant : adoptez un ton calme et confiant, évitez de montrer de l’empressement. On peut rappeler à la patiente qu’elle a bien fait de venir et qu’on va tout mettre en œuvre pour son confort.
-
Autoriser un accompagnant : si elle le souhaite et que c’est possible, la présence du conjoint ou d’une proche en salle d’examen peut la tranquilliser.
-
Aménagements pendant les soins : convenez avec elle d’un signe de la main si elle a besoin d’une pause. Assurez-vous qu’elle est bien installée, éventuellement avec un petit coussin sous les genoux ou derrière le dos pour améliorer le confort. En fin de grossesse, fractionnez les séances et laissez-la changer de position si nécessaire (tourner sur le côté quelques instants).
-
Gérer le réflexe nauséeux : le 1^er trimestre, et même après, certaines patientes ont un réflexe vomitif exacerbé. Utilisez un porte-langue, évitez de pencher trop la chaise en arrière, rincez souvent pour enlever les goûts désagréables (sang, etc.) qui pourraient déclencher des nausées. Un colutoires à la menthe douce ou un spray anesthésique léger au fond de la gorge peuvent aider à réduire le réflexe nauséeux.
-
Techniques de relaxation : guidez la patiente pour qu’elle respire lentement par le nez, bouche fermée, pendant les phases désagréables. On peut lui suggérer de se concentrer sur une musique (proposez-lui d’amener ses écouteurs et de la musique qu’elle aime). La sophrologie ou la respiration contrôlée peuvent être très utiles : certaines femmes enceintes connaissent déjà des techniques de respiration grâce à la préparation à l’accouchement, encouragez-les à les appliquer au cabinet.
Sédation légère au protoxyde d’azote (MEOPA)
Le protoxyde d’azote (gaz hilarant mélangé à l’oxygène) est une méthode de sédation consciente bien connue pour réduire l’anxiété et la douleur modérée en odontologie. Chez la femme enceinte, l’utilisation du protoxyde d’azote est possible à partir du 2<sup>e</sup> trimestre si nécessaire. En France, on utilise généralement un mélange équimolaire oxygène-protoxyde (50/50, appelé MEOPA) sous forme inhalée, qui a l’avantage d’agir rapidement et de s’éliminer vite. Le protoxyde induit une sensation de détente et peut aider les patientes très nerveuses à mieux tolérer les soins.
Précautions à respecter : Le 1^er trimestre de la grossesse est une contre-indication à la sédation au protoxyde d’azote, par principe de précaution (période clé de formation du fœtus). Après cette période, on peut l’utiliser occasionnellement, mais il faut s’assurer de disposer d’un système de scavenging (évacuation des gaz) efficace pour éviter l’exposition de l’équipe au N₂O, et de ne pas dépasser les concentrations nécessaires (souvent 30 % de N₂O suffisent chez la femme enceinte, car la sensibilité au gaz est accrue). On veillera à ce que la patiente respire bien par le nez dans le masque nasal, et on monitorera ses constantes si possible (le MEOPA en cabinet dentaire requiert une formation spécifique du praticien).
Les études disponibles n’ont pas montré d’effet délétère du protoxyde d’azote utilisé de façon ponctuelle pendant la grossesse, notamment au 2^e trimestre. Ainsi, en cas d’anxiété incontrôlable ou de réflexe nauséeux important, cette technique peut rendre de grands services. Par exemple, pour une patiente enceinte de 6 mois extrêmement phobique des soins, une sédation consciente au MEOPA, combinée à une anesthésie locale bien conduite, permettra d’extraire une dent infectée en toute sécurité alors que cela aurait été impossible autrement. Une fois le masque retiré, l’élimination du protoxyde est rapide (quelques minutes) et la patiente peut repartir après une courte surveillance.
Approche pharmacologique et autres options
En dehors du MEOPA, l’usage de médicaments anxiolytiques chez la femme enceinte est très restreint. Les benzodiazépines (Valium®, Lexomil®, etc.) sont déconseillées, surtout au 1^er trimestre (elles ont été incriminées dans un léger sur-risque de fente palatine lors d’usages répétés) et en fin de grossesse (risque de syndrome de sevrage et d’hypotonie néonatale si prises prolongées). Un diazépam en dose unique ponctuelle au 2^e trimestre n’entraînerait sans doute pas de complications majeures, mais ce n’est pas une pratique courante ni recommandée sans avis spécialisé. Si une patiente enceinte souffre de véritable phobie dentaire, la meilleure conduite est de l’adresser à un centre spécialisé où une sédation médicamenteuse approfondie (midazolam IV par exemple) ou une prise en charge sous anesthésie générale pourront être réalisées en milieu hospitalier sécurisé.
En alternative douce, mentionnons les médecines naturelles anxiolytiques : certaines patientes souhaitent éviter tout médicament et se tournent vers l’homéopathie ou la phytothérapie. L’efficacité de ces approches n’est pas formellement prouvée, mais leur innocuité est a priori bonne. Par exemple, la valériane et la passiflore sont deux plantes aux propriétés sédatives utilisées traditionnellement pour réduire l’anxiété ; elles pourraient apporter un léger apaisement pré-opératoire. Si la patiente en fait la demande, le dentiste peut l’autoriser à prendre ce type de complément en amont du rendez-vous (après s’être assuré auprès de son médecin ou pharmacien qu’il n’y a pas de contre-indication pour elle). Toutefois, il faut rester conscient que ces remèdes ont des effets modérés et variables selon les individus.
En pratique : La meilleure arme contre l’anxiété de la patiente enceinte reste l’empathie, la communication et l’adaptation. La très grande majorité des femmes enceintes se soignent sans problème particulier dès lors qu’on a su les écouter et les rassurer. N’hésitez pas à expliquer que les soins dentaires n’auront pas de conséquence négative sur le bébé – bien au contraire, une bouche saine contribue au bon déroulement de la grossesse. Par ailleurs, la patiente anxieuse appréciera que vous preniez en compte son état : proposez-lui d’aller à son rythme, montrez-lui que vous êtes attentif à son confort (pause toilette plus fréquente, etc.). Cette bienveillance aura un effet positif sur son stress. En dernier recours, si malgré tout la patiente est trop tendue, ne forcez pas un acte non urgent : reprogrammez la séance un autre jour éventuellement, en lui suggérant des techniques de relaxation à essayer d’ici là. Mais retenez qu’avec une bonne préparation et éventuellement l’aide du MEOPA à partir du 2^e trimestre, on parvient à traiter la plupart des patientes enceintes anxieuses dans de bonnes conditions.
Conclusion
Soigner une femme enceinte au cabinet dentaire nécessite quelques aménagements et connaissances spécifiques, mais cela s’inscrit dans la continuité des soins habituels. La grossesse n’est pas une maladie : une patiente enceinte a le droit et même le devoir de prendre soin de sa santé bucco-dentaire durant cette période cruciale. Les études et recommandations actuelles sont rassurantes : la prévention, le diagnostic et les traitements dentaires (y compris les radiographies avec protection et l’anesthésie locale) sont sans danger pendant la grossesse. À l’inverse, une infection dentaire négligée ou une douleur chronique non traitée peuvent avoir des répercussions néfastes sur la mère et l’enfant.
Le rôle du chirurgien-dentiste est donc d’accompagner la patiente enceinte avec pédagogie, de répondre à ses questions et de lui proposer les soins appropriés au moment opportun. En suivant les précautions détaillées dans ce guide – choix judicieux des médicaments, techniques anesthésiques maitrisées, radioprotection, adaptation des positions de traitement et gestion du stress – le praticien pourra travailler sereinement. N’hésitez pas à vous référer aux sources officielles (OMS, HAS, recommandations de sociétés savantes) et aux centres de pharmacovigilance en cas de doute sur une prescription. Avec une approche bienveillante et éclairée, le dentiste contribue au bon déroulement de la grossesse en maintenant la santé orale de sa patiente, ce qui est bénéfique pour la future maman comme pour son bébé.
Références :
-
Haute Autorité de Santé & Assurance Maladie – « Examen bucco-dentaire maternité », dispositif de prévention grossesse (2018-2024).
-
ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists) – Committee Opinion n°569: Oral Health Care During Pregnancy (2013, reaffirmed).
-
ADA (American Dental Association) – MouthHealthy: Pregnancy and Dental Concerns (2025).
-
RFCRPV Nouvelle-Aquitaine – Prise en charge des problèmes dentaires pendant la grossesse (2019).
-
UFSBD – Fiche Conseil: Grossesse et santé bucco-dentaire (mise à jour Juin 2024).
-
Le Courrier du Dentiste – « Les soins dentaires chez la femme enceinte » (Dossier, 2016).
-
Bennouna J. et al. – Thèse: Les techniques de sédation consciente en chirurgie orale (Casablanca, 2018).
-
MotherToBaby (OTIS) – Fact Sheet: Dental Work and Pregnancy (2021).
-
IRSN – FAQ Radiologie dentaire et grossesse (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 2020).
-
AAPD – Guideline on Perinatal Oral Health Care (American Academy of Pediatric Dentistry, 2017). (Pour la promotion de la santé orale pendant la grossesse).
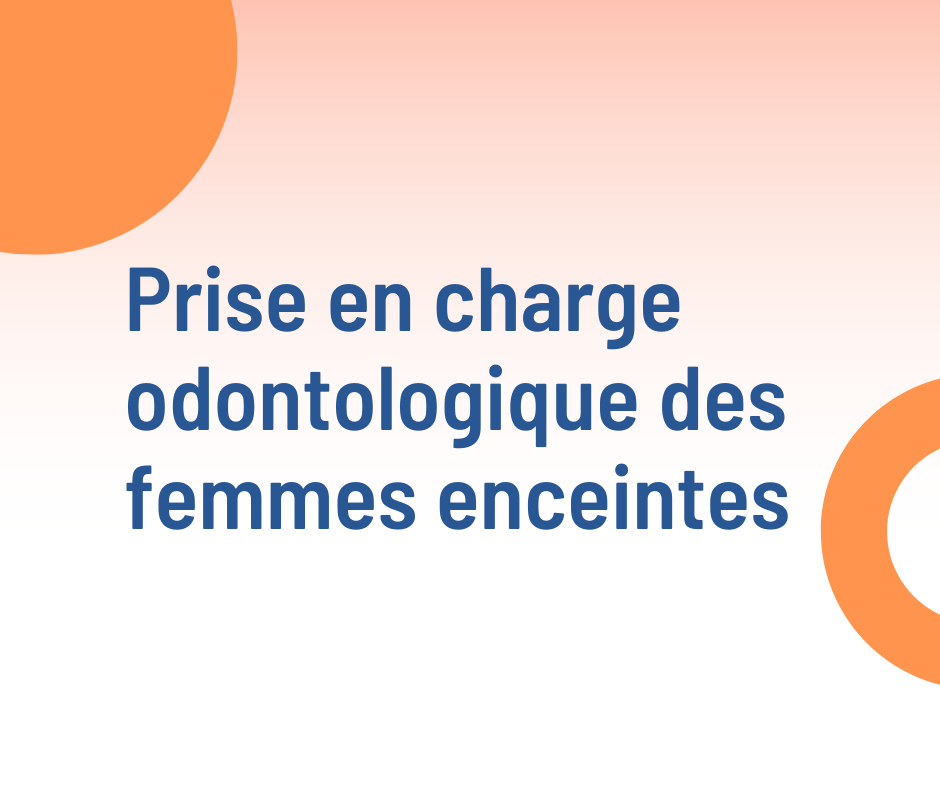

Commentaires
Connectez-vous pour laisser un commentaire.